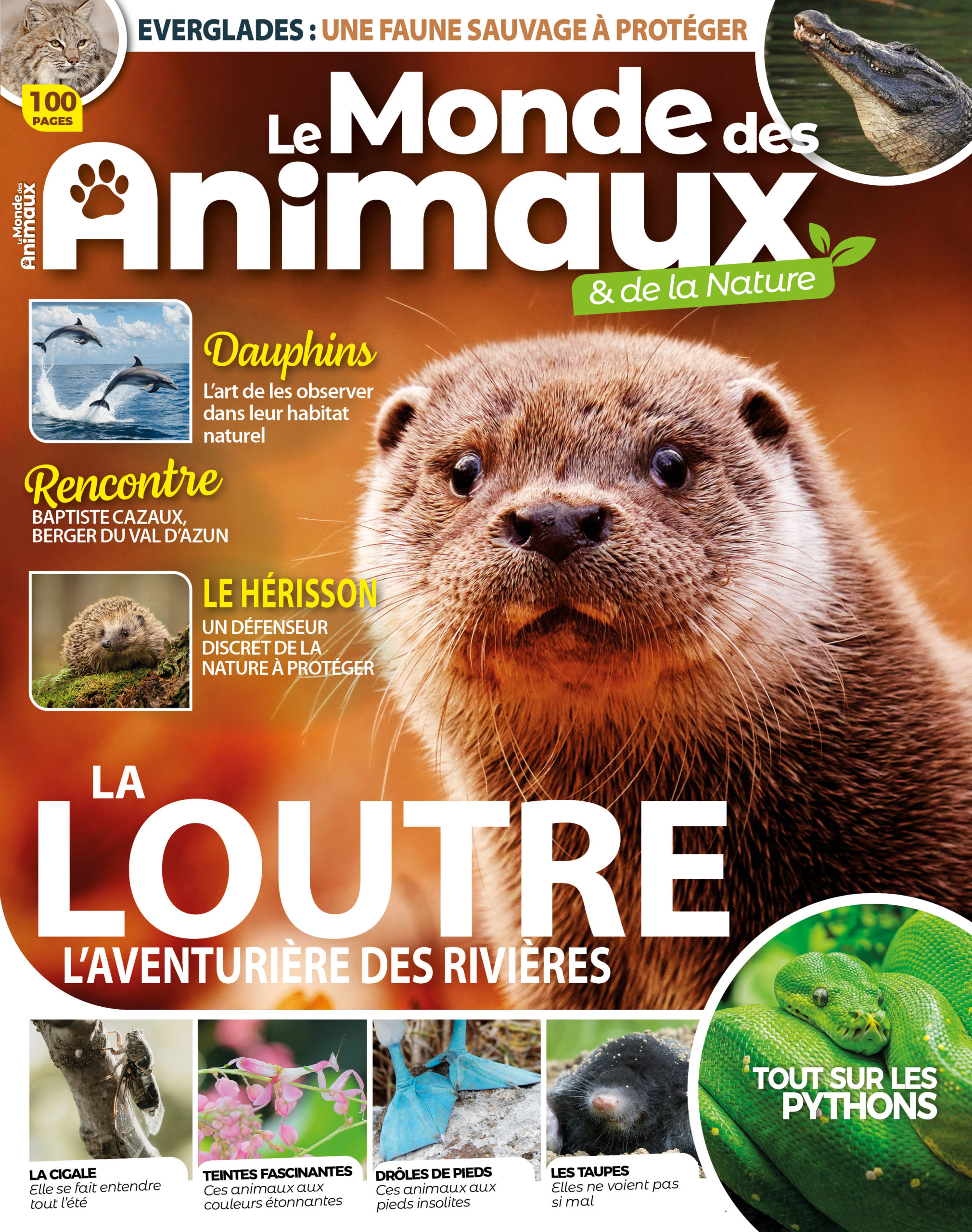« Les chevaux font partie de nous depuis bien avant que d’autres cultures ne viennent sur nos terres, et nous faisons partie d’eux », déclare le chef Joe American Horse, chef de l’Oglala Lakota Oyate, gardien des savoirs traditionnels, et coauteur de l’étude. En 2018, sur les instructions de ses aînés gardiens du savoir et chefs traditionnels, Yvette Running Horse Collin a pris contact avec Ludovic Orlando, scientifique du CNRS. Elle venait de terminer son doctorat, qui portait sur la déconstruction de l’histoire des chevaux dans les Amériques. Jusqu’alors, le domaine était dominé par des universitaires occidentaux et les voix des peuples indigènes avaient été largement ignorées. Son but était de développer un programme de recherche dans lequel les sciences indigènes traditionnelles pourraient être mises en avant et seraient considérées sur un pied d’égalité avec la science occidentale. Pour les Lakota, l’étude scientifique de l’histoire du cheval dans les Amériques fournissait le point de départ idéal, car elle mettrait en évidence les points d’accord et de désaccord entre approches occidentales et indigènes. Les anciens étaient clairs : travailler sur le cheval permettrait d’apprendre à combiner la puissance de tous les systèmes scientifiques, traditionnels et occidentaux. Dans l’espoir de trouver à terme, de nouvelles solutions aux nombreux défis qui affectent les populations, les communautés et la biodiversité dans le monde entier. Pour l’heure, comme ses ancêtres avant elle, Yvette Running Horse Collin allait donc suivre la voie tracée par la nation des chevaux.
Une partie du programme consistait à tester un récit qui figure dans presque tous les manuels sur l’histoire des Amériques : il s’agissait de déterminer si les documents historiques européens rendaient fidèlement compte de l’histoire des peuples indigènes et des chevaux dans les Grandes Plaines et les Rocheuses. Ce récit reflète les chroniques les plus connues établis par les Européens lors de leurs premiers contacts avec les groupes indigènes. Elles prétendent que les chevaux ont été adoptés récemment, à la suite de la révolte des Pueblos de 1680.
La science archéologique est un outil puissant pour comprendre le passé qui, si elle est pratiquée en collaboration, offre un cadre technique robuste pour contrer les préjugés intégrés dans les récits historiques. Au cours de la dernière décennie, Ludovic Orlando et son équipe de généticiens ont extrait les molécules d’ADN ancien encore préservées dans les vestiges archéologiques afin de réécrire l’histoire du cheval domestique. Ils ont séquencé les génomes de plusieurs centaines de chevaux ayant vécu sur la planète il y a des milliers d’années, et même jusqu’à 700 000 ans. Ils pouvaient donc raisonnablement s’attendre à ce que cette technologie révèle le patrimoine génétique des chevaux qui vivaient dans les Grandes Plaines et les Rocheuses après le contact avec les Européens.
Pour répondre à cette question, William Taylor, professeur adjoint à l’université du Colorado, et une vaste équipe de partenaires comprenant des archéologues de l’université du Nouveau-Mexique et de l’université de l’Oklahoma, ont entrepris, avec leurs collaborateurs Lakota, Comanche, Pawnee et Pueblo, de retrouver des ossements archéologiques de chevaux dans tout l’Ouest américain. En combinant des méthodologies éprouvées et innovantes dans le domaine des sciences archéologiques, l’équipe a identifié les vestiges de chevaux qui étaient élevés, nourris, soignés et montés par les peuples indigènes. La datation précoce obtenue pour un spécimen de cheval provenant de Paa’ko Pueblo, au Nouveau-Mexique, prouve que les indigènes contrôlaient les chevaux au début du XVIIe siècle, et peut-être même avant. La datation directe au carbone 14 de découvertes allant du sud de l’Idaho au sud-ouest du Wyoming et au nord du Kansas a aussi fourni la preuve que les chevaux étaient présents dans une grande partie des Grandes Plaines et des Rocheuses dès le début du XVIIe siècle, et sans aucun doute, avant la révolte des Pueblos de 1680. Il est clair que le récit le plus courant sur l’origine du cheval américain doit donc désormais être corrigé.
Les données génomiques ont démontré que les chevaux historiques les plus vieux analysés dans cette étude étaient principalement d’ascendance ibérique, mais n’étaient pas directement reliés aux chevaux qui ont habité les Amériques au pléistocène supérieur il y a plus de 12 000 ans. Ils n’étaient pas non plus les descendants des chevaux vikings, bien que ces derniers aient établi des colonies sur le continent américain en 1021. Les données archéologiques montrent que ces chevaux domestiques n’étaient plus sous le contrôle exclusif des Espagnols au moins au début des années 1600 mais qu’ils étaient déjà bel et bien intégrés dans les modes de vie indigènes. Ceci valide de nombreux récits traditionnels, relatant l’origine du cheval, comme ceux des Comanches et des Pawnees, tous deux parties prenantes de l’étude. Ainsi, Jimmy Arterberry, historien comanche et coauteur de l’étude, déclare : « Ces découvertes confirment la tradition orale comanche. Les traces archéologiques décrites sont des témoins inestimables qui revisitent la chronologie de l’histoire de l’Amérique du Nord, et sont tout autant importantes pour la survie des cultures indigènes. Elles constituent un patrimoine qui mérite d’être honoré et protégé. Ce patrimoine est sacré pour les Comanches. »
D’autres travaux impliquant de nouvelles fouilles archéologiques sur des sites datant du XVIe siècle ou même antérieurs, ainsi qu’un séquençage supplémentaire, permettront à l’avenir d’éclairer d’autres chapitres de l’histoire de l’homme et du cheval dans les Amériques. Carlton Shield Chief Gover, archéologue Pawnee et coauteur de l’étude, déclare : « La science archéologique présentée dans notre recherche illustre tous les bienfaits qu’il y a à développer des partenariats de collaboration sincères et équitables avec les communautés indigènes. »
Les analyses du génome n’ont pas seulement porté sur le développement de la relation homme-cheval au sein des Premières nations au cours des premières étapes de la colonisation américaine. Elles ont démontré que l’ascendance Ibérique, jadis dominante, s’est diluée au fil du temps pour s’enrichir d’une ascendance britannique. C’est donc toute l’évolution du paysage de l’Amérique coloniale qui a été enregistrée dans le génome du cheval : d’abord principalement à partir de sources espagnoles, puis principalement à partir de colons britanniques.
À l’avenir, l’équipe constituée pour cette étude s’est engagée à poursuivre son travail sur l’histoire de la nation du cheval dans les Amériques en continuant de faire place aux méthodologies scientifiques inhérentes aux systèmes scientifiques indigènes, pour par exemple retracer l’histoire des migrations et les effets des changements climatiques anciens. L’étude parue ce jour a ouvert la porte à ce programme ambiteux puisqu’elle a engagé un dialogue et des échanges authentiques entre scientifiques du monde occidental et des nations indigènes.
Les défis auxquels notre monde moderne est confronté sont immenses. En ces temps de crise de la biodiversité et de réchauffement climatique, l’avenir de la planète est menacé. Les peuples autochtones ont survécu au chaos et à la destruction engendrés par la colonisation, les politiques d’assimilation et le génocide, et sont porteurs de connaissances et d’approches scientifiques importantes axées sur la durabilité. Plus que jamais, il est temps de réparer l’histoire et de créer des conditions plus inclusives pour la co-conception de stratégies pour un avenir plus durable. Il est important de noter que cette étude a donné lieu à une collaboration entre des scientifiques occidentaux et de nombreuses nations autochtones des États-Unis, des Pueblo aux Pawnee, Wichita, Comanche et Lakota. Nous espérons que de nombreuses autres nations nous rejoindront bientôt. « Les chevaux font partie de notre famille et nous ont toujours rassemblés. Ils continueront à le faire. Nos sociétés sont organisées et prêtes pour cela. Notre collaboration scientifique est vouée à se développer encore plus : nous invitons tous les peuples cavaliers à se joindre à nous. Nous les appelons à nous. » (Antonia Loretta Afraid of Bear-Cook, gardienne du savoir traditionnel des Oglala Lakota, coauteure de l’étude).
Ce travail a été soutenu par la National Science Foundation Collaborative Research Award (#1949305, #1949304, #1949305, et #1949283), les actions Marie Sklodowska Curie (programmes HOPE et MethylRIDE), le CNRS et l’Université Toulouse III – Paul Sabatier (Programme international de recherche AnimalFarm), l’Investissement d’avenir France Génomique (ANR-10-INBS-09), et le Conseil européen de la recherche (PEGASUS). Tous les protocoles de transmission des connaissances sacrées et traditionnelles ont été respectés, et les activités et résultats de la recherche ont été approuvés par un comité d’examen interne composé de dix gardiens des connaissances Lakota, qui font désormais partie du conseil d’administration de Taku Škaŋ Škaŋ Wasakliyapi : Global Institute for Traditional Sciences (GIFTS).
*******
Source : CNRS
Photo © Sacred Way Sanctuary