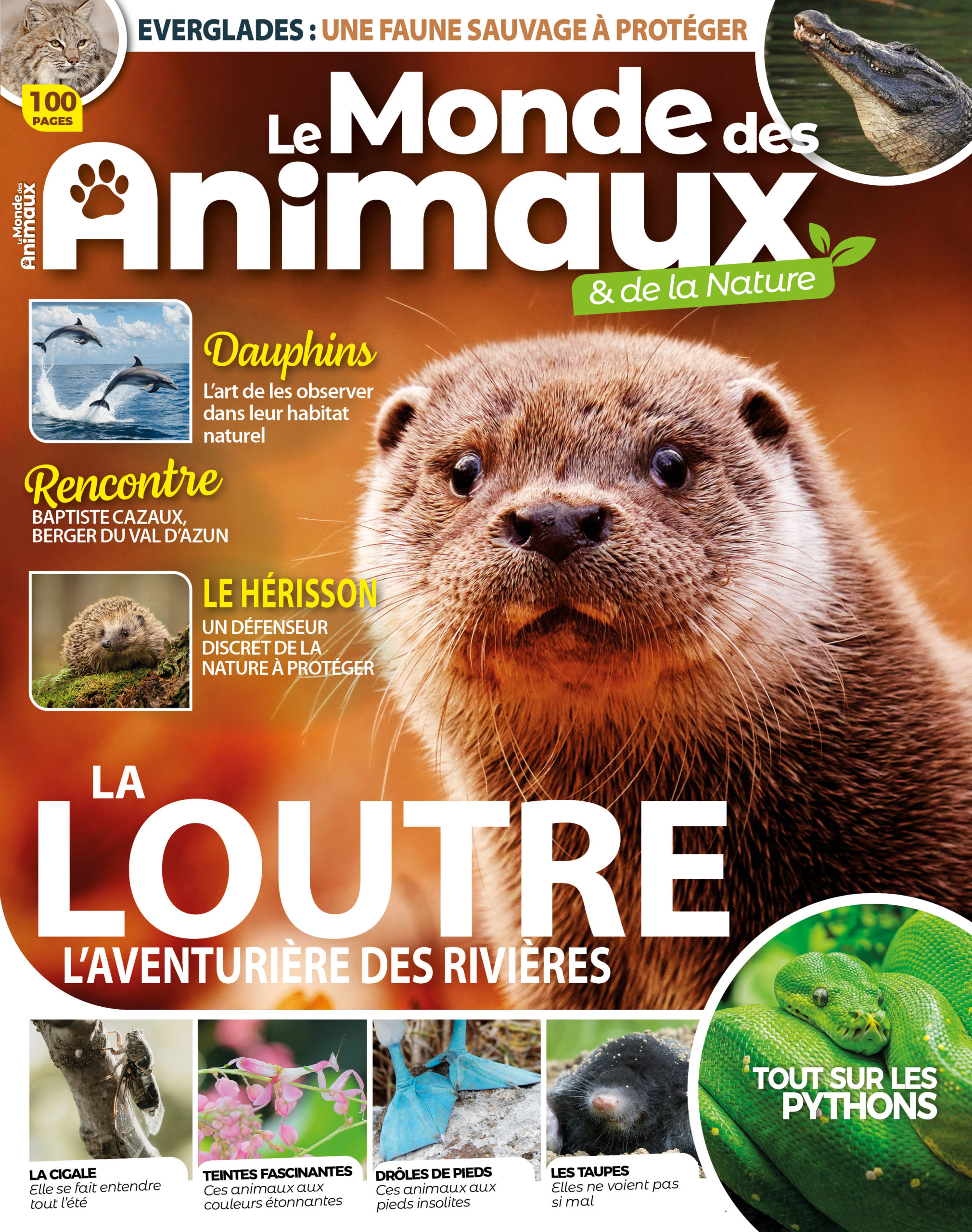Des scientifiques ayant suivis des baleines à bosses en Australie ont remarqué que les baleines étaient moins nombreuses à chanter pour trouver des partenaires au fur et à mesure que leur population augmentait.
« Le chant des baleines à bosse est puissant et se propage loin dans l’océan », indique la biologiste marine Rebecca Dunlop, qui étudie depuis plus de vingt ans les baleines à bosse qui se reproduisent près de la Grande Barrière de Corail.
Alors que le nombre de baleines s’est considérablement accru après l’arrêt de la chasse commerciale à la baleine, qui est l’une des plus belles réussites mondiales en termes de préservation, elle a remarqué quelque chose d’inattendu. « Il devenait plus difficile de véritablement trouver des baleines chanteuses, explique Rebecca Dunlop, qui travaille à l’université du Queensland, à Brisbane. Lorsqu’il y en avait moins, elles chantaient beaucoup plus. Maintenant qu’elles sont plus nombreuses, elles n’ont plus besoin de chanter autant. »
Les scientifiques ont d’abord commencé à entendre et à étudier les chants complexes des baleines à bosse dans les années 1970, grâce à l’apparition de nouveaux microphones pouvant aller sous l’eau. Seules les baleines mâles chantent et on estime que leurs chants jouent un rôle dans leur recherche de partenaires ainsi que dans l’établissement de relation de domination.
Les baleines à bosse de l’Australie de l’Est étaient menacées d’extinction dans la région dans les années 19060, puisqu’il ne restait qu’environ 200 individus. Cependant, les chiffres ont augmenté et atteint le nombre de 27 000 baleines en 2015, approchant ainsi des niveaux estimés avant le début de la chasse à la baleine. L’augmentation de la densité des baleines s’est accompagnée d’une modification de leur parade nuptiale. Alors que 2 mâles sur 10 étaient chanteurs en 2004, dix ans plus tard, ce ratio n’était plus que de 1 sur 10, ont rapporté Rebecca Dunlop et ses collègues en février dernier dans la revue Nature Communications Biology.
Rebecca Dunlop suppose que les chants ont joué un rôle prépondérant dans la recherche de partenaire lorsque leur population étaient très réduites. « Il était difficile de trouver d’autres baleines dans les environs car il y en avait peu », a-t-elle déclaré. Elle expliqua également que lorsque les baleines vivent dans des populations plus denses, un mâle cherchant une partenaire doit également éloigner la compétition, or chanter peut alerter d’autres prétendants.
« À mesure que leur population se rétablit, les baleines modifient de comportement et rencontrent ainsi de nouvelles contraintes », suggère le biologiste marin Boris Worm, de l’Université Dalhousie au Canada, qui n’a pas participé à l’étude.
Certes, les mers sont encore bruyantes. Selon les chercheurs australiens, de nombreuses baleines à bosse font la cour en combinant chant et bousculade.
« Un tel accroissement du nombre d’animaux au cours de la période étudiée leur a donné la rare opportunité d’avoir un aperçu des changements de comportements », a déclaré Simon Ingram, marin biologiste de l’Université de Plymouth en Angleterre, n’ayant pas participé à l’étude.
Selon Ingram, les baleines à bosse devaient chanter bien avant que la chasse à la baleine ne réduise leur nombre, mais la nouvelle étude souligne à quel point leurs chants élaborés et magnifiques étaient essentiels à leur survie et à leur rétablissement. « Il est clair que le chant était devenu incroyablement précieux lorsque leurs effectifs étaient au plus bas », a-t-il ajouté.
******
Source : phys.org
Photo : Todd Cravens / Unsplash