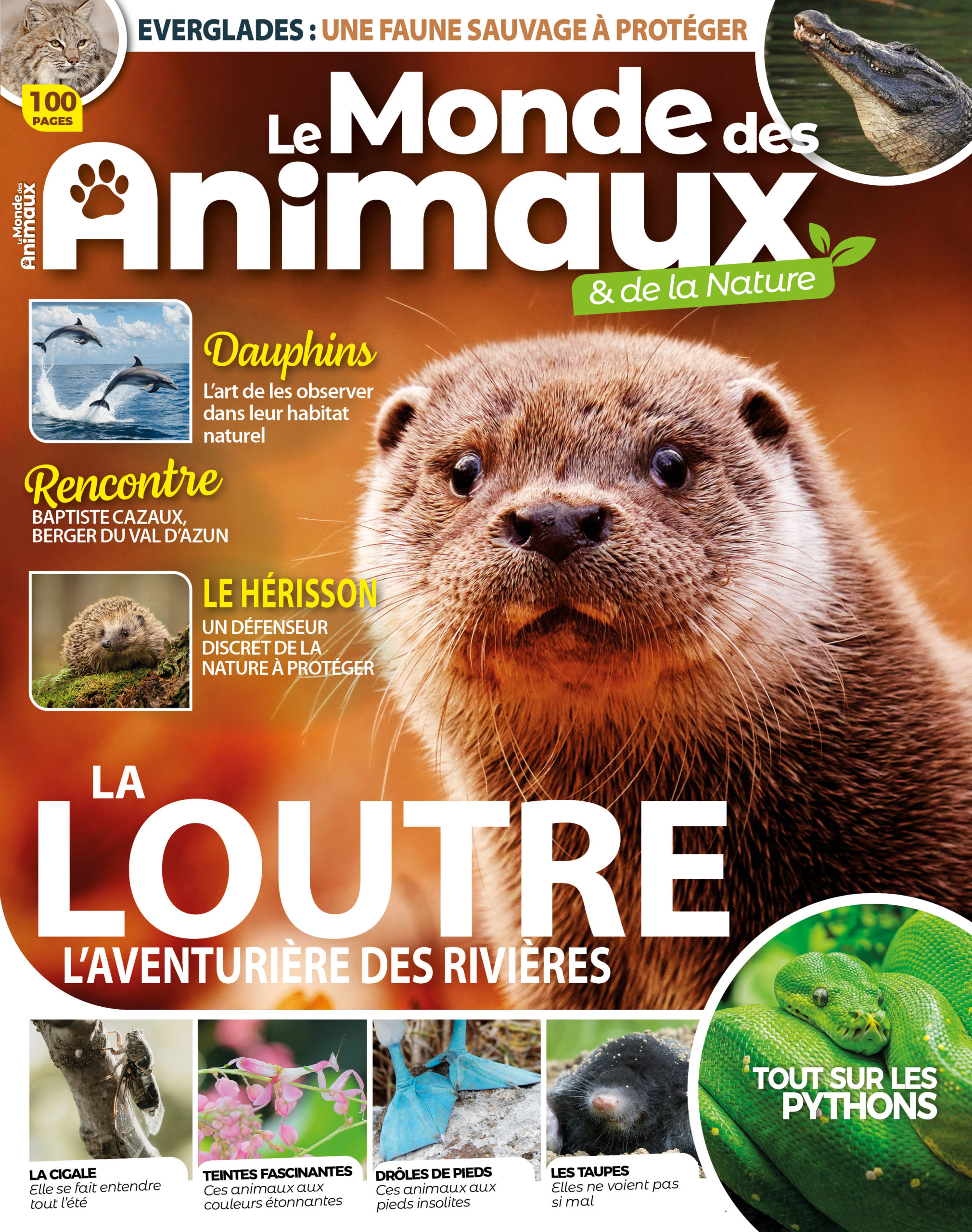Alors que les drones utilisent généralement des accéléromètres pour estimer la direction de la gravité, la façon dont les insectes volants y parviennent était jusqu’à présent entourée de mystère, car ils n’ont pas de sens spécifique de l’accélération. Dans cette étude, une équipe européenne1 de scientifiques menée par l’Université de Delft aux Pays Bas et impliquant un chercheur du CNRS a montré que les drones peuvent évaluer la gravité, en utilisant conjointement la détection visuelle du mouvement et la modélisation de leurs déplacements.
Pour élaborer ce nouveau principe, les scientifiques se sont intéressés au flux optique, c’est-à-dire à la façon dont un individu perçoit le mouvement relatif à son environnement. C’est le mouvement visuel qui défile sur notre rétine lorsque l’on se déplace. Par exemple, quand on est dans un train, les arbres à côté des rails passent plus vite que des montagnes lointaines. Le flux optique seul n’est pas suffisant pour qu’un insecte soit en mesure de connaitre la direction de la gravité.
Cependant, l’équipe de recherche a découvert qu’il leur était possible de retrouver cette direction en combinant ce flux optique avec une modélisation de leur mouvement, c’est-à-dire une prédiction de leurs déplacements. Les conclusions de l’article montrent qu’avec ce modèle, il était possible de trouver la direction de la gravité dans presque toutes les situations, sauf dans quelques rares cas spécifiques comme lorsque le sujet est complètement immobile.
Lors de vols parfaitement stationnaires, l’impossibilité de retrouver la direction de la gravité va déstabiliser un instant le drone et donc le mettre en mouvement. Cela permet au drone de retrouver la direction de la gravité à l’instant suivant. Ces mouvements génèrent ainsi de légères oscillations, ce qui rappelle le vol des insectes.
Utiliser ce nouveau principe en robotique pourrait permettre de relever un défi majeur auquel la nature a également dû faire face : comment obtenir un système entièrement autonome tout en limitant la charge utile. Les futurs prototypes de drones se verraient allégés en se passant d’accéléromètres, ce qui est très prometteurs pour les plus petits modèles de la taille d’un insecte. Si cette théorie peut expliquer comment les insectes volants déterminent la gravité, reste à vérifier qu’ils utilisent effectivement ce mécanisme. De nouvelles expériences biologiques spécifiques sont nécessaires. Une équipe de chercheurs européens a établi un nouveau principe qui expliquerait comment les insectes volants déterminent la direction de la gravité, sans utiliser d’accéléromètres. Ces résultats constituent une étape importante dans la création de minuscules drones autonomes. Comment les insectes volants et les drones peuvent-ils discerner le haut du bas ? pour prouver l’existence de ces processus neuronaux difficiles à observer en vol. Cette publication montre comment la synergie entre la robotique et la biologie peut conduire à des avancées technologiques et à de nouvelles voies pour la recherche biologique.
Source : CNRS
Photo : Shutterstock