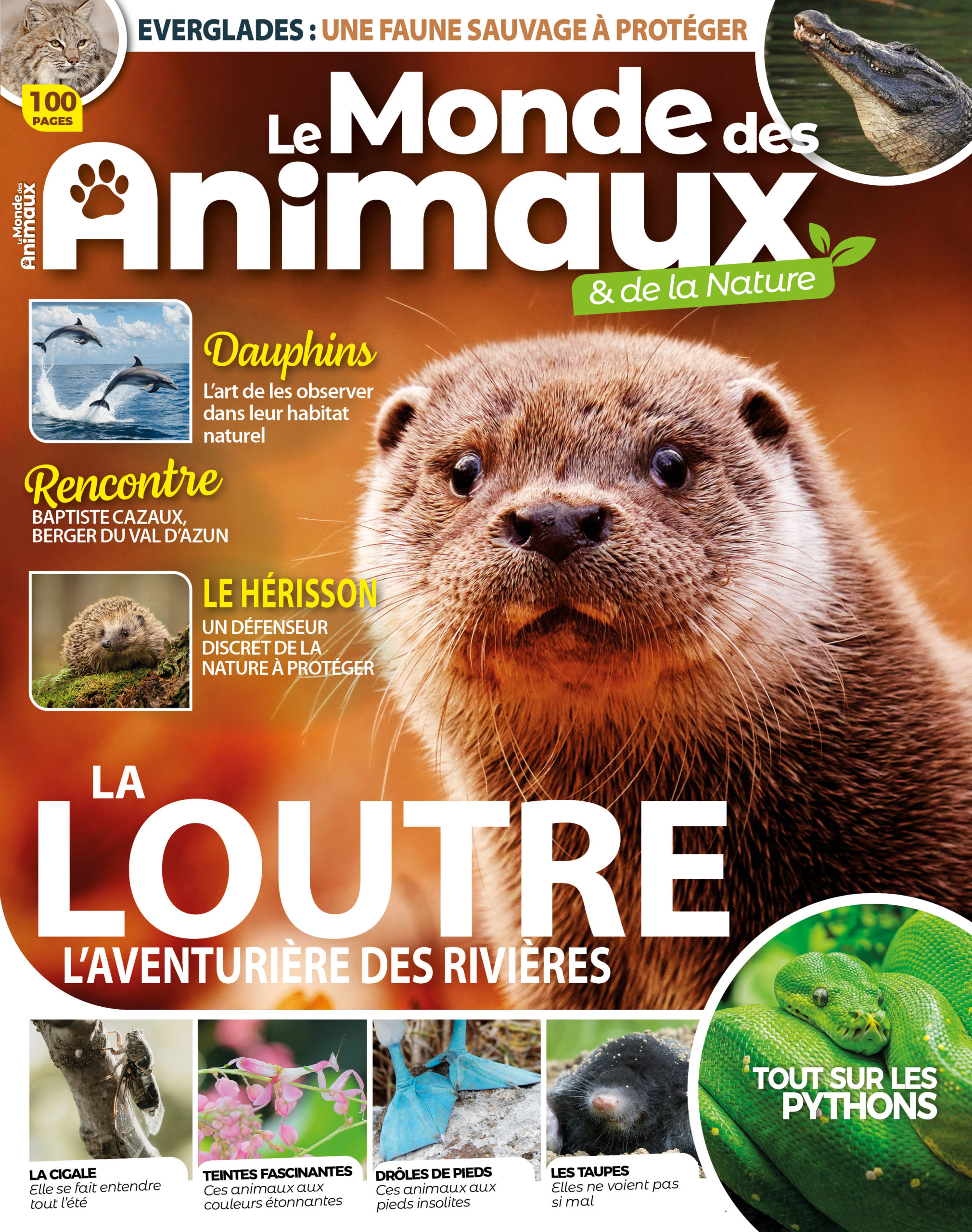Grâce aux séquençages génétiques des échantillons prélevés sur les stands du marché après sa fermeture le 1er janvier 2020, les scientifiques ont mis en évidence la co-présence en ce lieu du matériel génétique du virus SARS-CoV-2 et de celui de certains animaux sauvages. Parmi les espèces identifiées figurent notamment les chiens viverrins et les civettes, deux espèces déjà impliquées dans l’émergence du SARS en 2002 et considérées comme facilitant le passage du virus aux humains.
Les échantillons avaient été séquencés grâce à une technique dite méta-transcriptomique, qui a permis à l’équipe de recherche d’identifier l’ensemble du matériel génétique des organismes présents dans chaque échantillon (qu’il s’agisse de virus, bactéries, plantes, animaux ou humains). L’analyse des données de séquençage a permis de caractériser le génotype des animaux présents sur le marché et de retracer leur origine géographique probable.
En parallèle, les scientifiques ont étudié les génomes viraux des premiers patients atteints de COVID-19 afin de retracer l’évolution possible du virus. Ils ont ainsi mis en évidence que la diversité génétique du virus présente dans le marché était représentative de la diversité génétique des cas humains précoces de la pandémie. Ce résultat, cohérent avec une origine au marché, s’ajoute à d’autres déjà existants comme la localisation des premiers cas à proximité du marché de Huanan.
Ainsi, l’ensemble de ces nouvelles informations va dans le sens de l’hypothèse selon laquelle la pandémie aurait été déclenchée par l’introduction d’animaux infectés sur le marché à la fin 2019.
L’étude révèle également la présence d’autres virus zoonotiques sur le marché, soulignant le risque élevé de nouvelles pandémies liées à la vente d’animaux vivants au sein de villes densément peuplées. Identifier les activités humaines les plus susceptibles de déclencher de nouvelles pandémies est en effet crucial pour mieux anticiper et prévenir ces crises sanitaires.
*****
Source : CNRS
Photo : WildMedia / Shutterstock