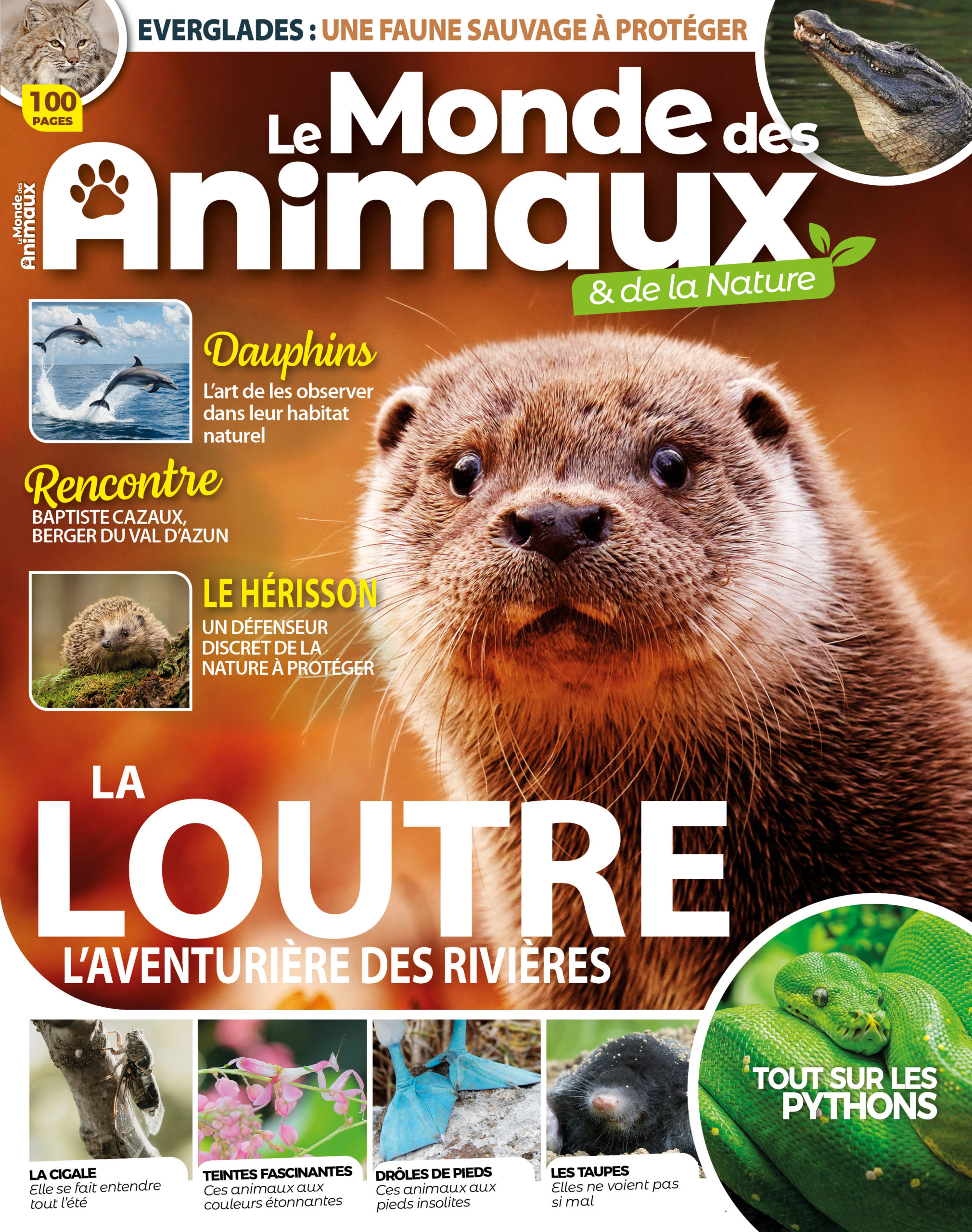Ces dernières années, la panthère des neiges a occupé la plupart de vos voyages. Pour quelle raison ?
Je reste un grand gamin qui se nourrit encore de ses rêves et d’images d’animaux mythiques. Cette panthère, je l’ai découverte à travers les récits d’aventures du biologiste américain George B. Schaller. Dans le Chitral, au Pakistan, il l’avait filmée dans les années 1970. Mais en partant pour la première fois au Tibet, en 2011, je croyais modérément à la possibilité de la voir. En revanche, je savais que j’allais croiser d’autres espèces tout aussi énigmatiques. J’ai ainsi passé un mois sans la voir – juste une trace –, mais c’était passionnant de la savoir présente. C’est d’abord le yack sauvage, animal totem d’une autre époque, probablement contemporain des mammouths ou rhinocéros laineux, qui m’a attiré sur ces hauts plateaux. Tout comme les bœufs musqués en Arctique. La panthère, au fond, est un prétexte. Un prétexte somptueux, mais un prétexte.
Qu’est-ce qui vous a fait revenir si souvent sur ses traces ?
Tout comme en Arctique, j’aime revenir sur les mêmes lieux… J’aime les découvrir à mon rythme, petit à petit, au long cours, souvent seul. Quelle satisfaction d’apprendre doucement à lever le voile sur les bêtes sauvages, à force de les imaginer, de les pister, de les observer ! J’ai en effet toujours préféré me concentrer plusieurs années de suite sur un sujet plutôt que de papillonner et de passer d’un reportage à un autre : fuir les commandes, suivre mon instinct.
Concernant le Tibet, je dois en être à mon huitième voyage. Je les ai entrepris au départ pour des photos et un livre, puis s’est imposée cette envie de film, avec une petite équipe de deux à trois personnes maximum pour éviter de déranger et être souples et flexibles dans ces milieux compliqués de très haute altitude. Léo-Pol Jacquot travaille à mes côtés depuis huit ans, essentiellement au bureau : j’étais ravi de l’éloigner un peu de ses écrans et de l’embarquer là-haut ! N’ayant quasi aucune expérience de terrain, il m’a épaté par sa capacité à s’adapter. Marie Amiguet avait quant à elle un regard neuf à offrir sur les lieux, une sensibilité singulière ; et j’appréciais sa discrétion de panthère. Sa mission était de nous suivre en se faisant oublier, pour nous filmer sans aucune mise en scène afin d’être au plus proche de la réalité. Cette méthode amène son lot de maladresses ou de faiblesses techniques, mais aussi une certaine sincérité des moments saisis. L’objectif, c’était que soient captées les émotions telles qu’elles nous traversaient.
Dans La Panthère des neiges, l’écrivain Sylvain Tesson accompagne. Comment le voyage s’est-il organisé ?
Sylvain et moi nous étions déjà croisés plusieurs fois, et il avait émis le désir de me suivre en affût. Je connaissais ses écrits d’aventures, mais c’est spécialement son livre Sur les chemins noirs qui m’a séduit. On y sentait une fibre écologique en filigrane. Naturellement, je l’ai invité pour clôturer mes aventures par un livre avec ses textes, et ce film. Comme souvent, j’ai à cœur de lancer des passerelles : transmettre l’émerveillement, suivre le rythme lent de la nature dont on s’imprègne complètement au fil des heures et des observations.
Il s’agissait donc de filmer l’échange entre lui et moi autour d’un même rêve, tout en utilisant les images animalières accumulées lors de mes précédentes aventures là-haut. En parallèle, l’idée était de proposer un bel objet associé, un album dont les photos porteraient des légendes rédigées par l’écrivain. C’est mon côté artisan : suivre toutes les étapes à mon rythme, pour être au plus près de ce que je veux réellement partager, sans contraintes ni pression.
En partant au Tibet, étiez-vous assuré de voir une panthère des neiges ?
Ce qui est fort, dans ce projet, c’est que tout s’est aligné. Il n’y avait pourtant rien d’évident, au départ, à ce que cette combinaison fonctionne. Et absolument aucune garantie que Sylvain finisse effectivement par la voir, cette panthère. Et puis, les tout derniers jours, elle s’est montrée ! Quand je me suis extirpé du duvet et de la grotte, et que je l’ai vue manger sa proie, tuée la veille, c’était un moment incroyable ! Quelque chose d’impossible à scénariser au préalable, évidemment.
Pouvez-vous nous raconter votre première rencontre avec la panthère des neiges ?
Quel moment ! Mais c’est d’abord le pistage qui est passionnant : chercher les traces, lire les indices, passer des journées entières les yeux rivés aux jumelles. C’est tellement excitant de la pister ! Elle a un petit côté diabolique, au fond, à nous observer en permanence sans que nous soyons capables de l’apercevoir. Elle nous oblige à fonctionner un peu comme elle : à nous cacher, à nous camoufler, à ne surtout pas être intrusifs. Voilà ce qu’elle nous apporte. La première fois, les choses sont allées doucement crescendo : d’abord, des traces anciennes, puis des traces fraîches, un cri de corbeau (qui suggérait la présence d’un prédateur dans le coin), le temps qui change (ce qui pousse souvent les animaux à se déplacer)… Et alors que j’alignais des heures et des heures d’observation dans les jumelles, elle est soudain entrée dans mon champ de vision. Elle est passée sans me voir ! C’était comme une parfaite entrée de champ dans un film animalier. J’ai ressenti d’autant plus de satisfaction que je ne l’avais pas perturbée dans son déplacement.
Vous avez emmagasiné une connaissance très fine de la nature et de ses habitants au fil des reportages. Votre instinct joue-t-il aussi un rôle dans vos déplacements et dans vos prises de décision ?
Oui, un rôle énorme. Je crois très fort en la notion d’instinct. Il est difficile de décrire la façon dont notre corps est partie prenante dans ces moments-là, dans nos réactions et les choix que nous faisons. Notre être s’imprègne de tout : tous nos sens sont mobilisés ; nous entrons comme en vibration avec l’espace qui nous entoure et le vivant qui l’habite. Les émotions sont littéralement exacerbées, et notre part animale retrouve enfin le moyen de s’exprimer. Cependant, les échecs sont réguliers – et tant mieux ! Ils nous permettent de nous rendre compte à quel point nous sommes vulnérables là-bas.
Vous dites dans le film : « Je n’ai pas une démarche de photojournaliste, à montrer ce qui ne va pas dans la nature. » Recueillir ses beautés, n’est-ce pas un peu faire l’inventaire de ce qui va bientôt disparaître ?
C’est tristement vrai ! Et il se trouve que je ne suis pas assez armé pour poser mes caméras là où c’est dur, sombre, là où l’horreur s’est imposée. Je rends d’ailleurs hommage à ceux qui sont capables de s’y confronter. Moi, par nature, je tends à me nourrir de la poésie, de la beauté, même lorsqu’elle est extrêmement vulnérable, et j’aurais bien du mal à me faire le témoin uniquement de catastrophes écologiques.
Depuis quelques années, vous filmez plus souvent que vous ne photographiez. Pour quelle raison ?
Je me suis pris au jeu dès que la fonction caméra a été ajoutée sur nos boîtiers photo, il y a une dizaine d’années. Au point que, dans les Asturies, où j’ai récemment réalisé un film sur les ours, je n’ai pas fait de photos du tout. Il me semble que l’image en mouvement est un moyen un peu plus évident pour faire passer des émotions. Pouvoir également intégrer du son, qui transmet ainsi l’écho du paysage, ses ambiances, ses résonances, c’est excitant. Mais un film, c’est aussi plus long et plus lourd à mettre en œuvre.
Après l’avoir croisée à plusieurs reprises, la panthère vous fait-elle encore rêver aujourd’hui ? Que représente-t-elle à vos yeux ?
La première rencontre est forcément inoubliable. Comme toutes les premières fois essentielles : avec le lynx boréal chez nous en France, que j’ai attendu pendant 15 ans, après moult bivouacs. Je l’entendais feuler, mais de là à le voir ! Et enfin, le jour où il se montre, on approche quelque chose de l’ordre de l’absolu, qui nous hante pendant longtemps. De même, je me sens hanté par le souvenir de la présence fantomatique de la première meute de loups blancs que j’ai observée dans le Haut-Arctique canadien. On finit par se demander si ces visions relèvent du fantasme ou de la réalité, tant elles nous habitent. Et il n’y a pas que l’image ! Les odeurs, les bruits : tout nous imprègne durablement. Quelque chose d’extérieur à nous vient se loger en notre intérieur, et nous met en mouvement. Comme l’a fait le tout premier chevreuil que j’ai photographié à l’âge de 12 ans, et qui a fait basculer ma vie. Voilà l’effet que produit la panthère des neiges sur moi encore aujourd’hui.