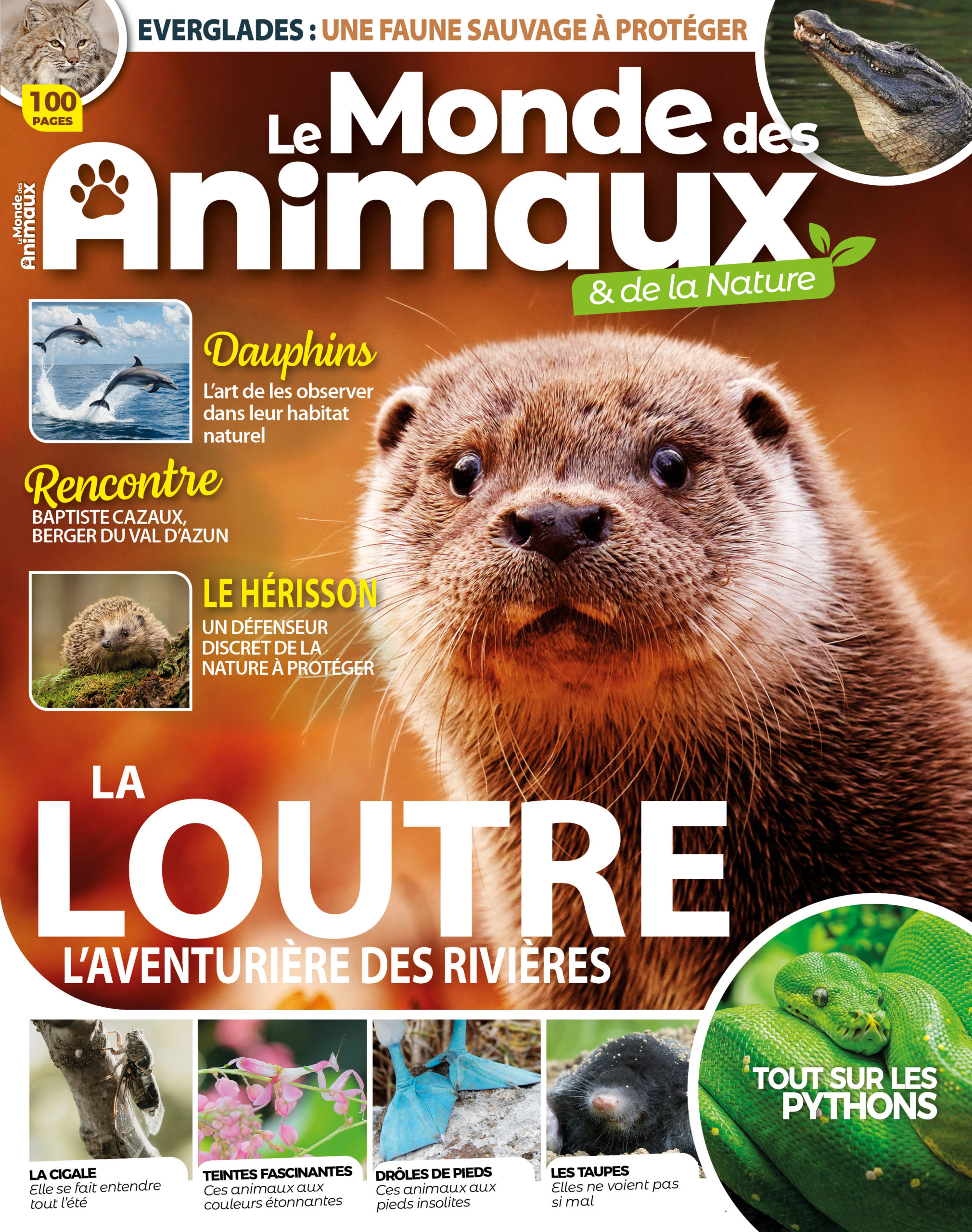Anne est une jeune femme de 27 ans qui a débarqué avec ses parents en France depuis les Pays-Bas à l’âge de 7 ans. Passionnée par l’Hexagone et les animaux, la famille s’est installée dans le nord de l’Ardèche pour vivre au plus près de la nature.
Alors que les traitements médicamenteux prescrits par son vétérinaire ne parviennent pas à soigner la blessure de sa jument, une amie lui propose de faire appel à un ostéopathe animalier. C’est une révélation. Non seulement le thérapeute soigne sa jument, mais il lui transmet en plus la passion de son métier. Pour Anne, sa voie est dès lors toute tracée : elle sera ostéopathe animalière.
Après sa scolarité qu’elle réussit brillamment, elle décide de s’installer en Savoie, du côté d’Albertville, et de prodiguer ses soins aux bêtes en sillonnant les routes du Beaufortain. Elle m’explique à demi-mots : « Pas facile de se faire une place au soleil dans ce milieu rural, surtout quand tu es une femme et que tu arrives avec une technique thérapeutique que peu de gens connaissent. Je partais quand même avec deux gros handicaps. »
Mais avec beaucoup de patience, d’explications, de respect et de bons résultats sur les bêtes, on arrive à tout, et aujourd’hui Anne a un carnet de rendez-vous bien rempli. Entre les chiens et les chats à son cabinet, et les animaux de la ferme chez les agriculteurs, ses journées commencent tôt et se terminent tard. La jeune femme m’avoue d’ailleurs manger souvent un sandwich au volant de son pick-up, entre deux rendez-vous. Un comble quand on habite dans une région riche d’une forte identité gastronomique !
Chez Marie et Carole
Ce matin, Anne me propose de la suivre à la ferme de Marie et de Carole sur les hauteurs des Saisies. Ces deux sœurs ont repris la ferme familiale en 2012 et gèrent un troupeau de 48 vaches abondances qui produisent du lait pour la coopérative laitière du Beaufortain et qui sert à la fabrication du beaufort, l’un des cinq fromages AOP de Savoie avec le chevrotin, le reblochon de Savoie, la tome des Bauges et l’abondance.
Depuis quelques jours, une vache du troupeau a des problèmes musculaires à une patte et les sœurs souhaitent lui apporter un soin complémentaire aux traitements vétérinaires. L’ostéopathie animale répond parfaitement à la demande, car elle est moins invasive. C’est une manipulation douce des muscles et des articulations qui permet de soulager les tensions et les blocages.
Anne s’approche avec respect de la génisse, qui doit faire dix fois son poids. Elle lui tend la main et se laisse renifler. Il y a du respect dans les gestes, de la tendresse dans le regard et une certaine forme d’élégance. Une fois que l’animal semble avoir donné son accord, Anne en fait le tour tout en passant sa main avec douceur sur l’ensemble de son corps. Un ballet se met alors en place entre la thérapeute et l’animal, puis Anne s’arrête net sur un point précis du dos, juste au-dessus de la patte fragilisée. « Tu vois, me dit-elle. C’est ici que ça se joue. Le muscle coincé dans la patte irradie jusqu’au sommet de son dos. Et c’est là que ça lui fait mal. Je vais devoir débloquer son membre pour que la douleur sur le haut du dos s’estompe petit à petit. »
L’ostéopathie animale fonctionne exactement comme l’ostéopathie humaine ; elle utilise les mêmes techniques et agit sur les mêmes points. Du haut de son 1,58 m et de ses 58 kg, Anne s’empare doucement de la patte de la vache qu’elle vient caler entre ses jambes et remet en place les muscles d’un coup délicat et sec. Un petit claquement se fait entendre, mes poils se hérissent sur mes bras, mais à ma grande surprise la vache ne bouge pas. Elle semble même soulagée du geste juste et parfait que vient d’accomplir Anne. Elle tourne doucement la tête vers la thérapeute, la baisse même un peu, comme pour la remercier et lui faire comprendre que la douleur vient de disparaître sur un claquement de doigts.
Je suis estomaqué par la maîtrise du geste et par le respect qui s’est instauré entre ces deux êtres. Une connexion parfaite entre la jeune femme et l’animal.
Chez Cyril
La vache à peine remise sur pattes, nous voilà repartis sur les routes sinueuses de Savoie en direction de la ferme de Cyril. Ce berger de 26 ans a lui aussi repris les rênes de la ferme familiale et gère 110 chèvres avec l’aide de quelques stagiaires et apprentis. Le cheptel produit du lait que Cyril va lui-même transformer en fromage dans son laboratoire flambant neuf, avant de le vendre sur les marchés de la région. La traite a lieu deux fois par jour, mais Cyril peut compter sur un système mécanique pour l’aider. Il faut ainsi trois quarts d’heure pour traire l’ensemble des bêtes qui produisent plus de 250 litres de lait par jour.
C’est la première fois qu’Anne rencontre Cyril. Le jeune homme a entendu parler de l’ostéopathe, dont la réputation se répand comme une traînée de poudre dans la vallée. Le jeune homme est de cette nouvelle génération qui pense que le bien-être animal doit être au cœur du métier de berger. Si un animal est heureux et en pleine forme, son rendement sera meilleur, son lait sera plus doux et le goût de ses fromages sera forcément meilleur.
Cyril montre à Anne une des chèvres, qui boite légèrement. Tout comme la vache, en une fraction de seconde, Anne débloque la situation. Cyril m’explique : « Je ne veux pas faire de la surproduction. C’est pour cela que je limite ma production de fromage. Mes bêtes mangent de la bonne herbe et broutent dans les alpages autour de chez moi. Quand elles souffrent, je fais intervenir systématiquement un professionnel tout de suite. Avoir rencontré Anne est une bénédiction. Je suis persuadé qu’elle va apporter beaucoup de bien-être à mes bêtes. »
Cyril croit au circuit court et à la production locale. Tout comme Anne, il fait partie de cette nouvelle génération de professionnels du monde animal qui apporte une nouvelle vision de leur métier : « Connaître nos racines, savoir d’où l’on vient et être tourné vers l’avenir, sans jamais se fermer aux nouvelles techniques et technologies, voilà notre futur. »
J’ai été véritablement séduit par le dynamisme de ces deux jeunes, passionnés par leur métier et surtout par leurs animaux. Décidément, l’avenir entre l’homme et l’animal nous réserve de belles histoires pour peu que nous soyons respectueux et à l’écoute les uns des autres.


Par Gérald Ariano
Dans chaque épisode d’“Une vie de bêtes” sur Ushuaïa TV, Gérald Ariano part à la rencontre des professionnels du monde animal. Chacune de ces rencontres est l’occasion pour lui de travailler à leurs côtés et de découvrir les particularités de ces métiers passionnants.
© TF1 ; G2AMEDIA