
Qu’est-ce qui vous passionne dans l’éthologie et le comportementalisme ?
Ces disciplines sont passionnantes car, au-delà de leur intérêt scientifique et des avancées qu’elles permettent d’obtenir dans la connaissance du monde animal, elles éclairent aussi sur les comportements humains. L’homme est un animal certes un peu différent des autres, de par ses capacités intellectuelles et de communication verbale, mais qui applique lui aussi sans forcément le savoir des codes de communication et les adapte à sa façon.
L’approche éthologique a révolutionné la connaissance du comportement et permet de comprendre beaucoup plus finement des attitudes animales qui étaient rangées dans la catégorie des “troubles du comportement“ auparavant et qui, en fait, font partie du répertoire comportemental normal du chien et du chat mais sont juste exprimées à mauvais escient… bien souvent uniquement du point de vue du propriétaire.
À la différence des humains, les animaux ne calculent pas et sont bien plus honnêtes que nous dans leurs comportements. Quand ils agissent de façon inappropriée, il y a toujours une raison et bien souvent ils sont victimes plutôt que coupables.
Comment définiriez-vous la communication animale ? Comment les animaux parviennent-ils à communiquer sans mots et comment pouvons-nous les comprendre ?
Dans le règne animal comme chez l’homme, la communication fait intervenir au moins un animal émetteur et un animal récepteur. Chez les animaux, elle vise un objectif principal : survivre, en s’adaptant pour cela à d’éventuelles modifications des conditions environnementales, en trouvant à manger, en conviant des partenaires sexuels pour la reproduction – donc pour assurer la pérennité de l’espèce –, en tenant à distance les prédateurs ou un compétiteur, en provoquant le conflit quand le groupe social est menacé, etc.
Un animal émet un signal de communication pour induire un changement de comportement chez un autre, les intérêts de l’émetteur et du récepteur pouvant être convergents ou non.
On distingue deux types de communication : la communication intraspécifique, entre des individus de la même espèce, et la communication interspécifique, entre des individus d’espèces différentes, par exemple entre l’homme et ses animaux de compagnie. Pour se comprendre, les animaux font appel à différents signaux non verbaux : vocalises, postures, mimiques… Les “codes” de la communication sont spécifiques à chaque espèce. Par exemple, un chien qui remue la queue exprime en général sa joie, tandis que chez le chat cette attitude témoigne plutôt de son énervement.
Comprendre ses animaux de compagnie implique de leur consacrer du temps et nécessite beaucoup d’observation. Chaque animal est unique et adapte la communication de son espèce à sa manière.
La communication entre animal et humain est-elle différente de la communication entre différentes espèces animales ?
Pas fondamentalement puisqu’elle fait intervenir des signaux de communication identiques, à l’exception des marqueurs olfactifs que nous ne sommes a priori pas capables de décrypter !
Nos chiens et chats manifestent leurs attentes par leurs vocalises, leurs postures, nous sollicitent plus ou moins ouvertement en posant une patte ou leur museau sur notre bras. Ils savent être très expressifs. Cette communication interspécifique s’initie et s’entretient. Elle se prépare très tôt dans la vie du chiot et du chaton, lors de la phase dite de socialisation au cours de laquelle il apprend à vivre avec une espèce très différente de la sienne et à ne pas la craindre.
La communication s’entretient ensuite tout au long de la vie de l’animal et se perfectionne à mesure que la complicité avec son compagnon grandit. Les propriétaires sont nombreux à dire qu’ils “comprennent” leur animal et sont même capables d’anticiper ses réactions. Cette compréhension s’améliore avec la cohabitation et dépend bien sûr du temps et des attentions qu’on réserve à son chien ou à son chat. D’autant plus que l’animal apprend aussi à communiquer par imitation… et inversement ! Pour inciter son chien à jouer, l’humain va par exemple naturellement s’accroupir, ouvrir ses bras, voire taper sur ses cuisses, copiant ainsi inconsciemment la posture d’appel au jeu du chien.
Homme et animal mettent aussi souvent en place, volontairement ou non, des rituels qui facilitent leur communication mutuelle.
Est-il plus facile de communiquer avec certains animaux de compagnie ? Par exemple, dialogue-t-on plus facilement avec un chien qu’avec un chat ?
Tout dépend de son expérience personnelle et de sa familiarisation avec l’espèce en question. Les possesseurs de chiens vous diront que cet animal est plus “franc”, plus direct que le chat et donc plus facile à comprendre. Les propriétaires de chats pensent l’inverse, que leur animal “s’exprime” plus finement et ne communique qu’à bon escient. Tout est question de perception individuelle et d’affinités personnelles.
Chien ou chat peuvent se faire comprendre à mon avis tout aussi facilement.
Dans quelle mesure la communication animale peut-elle aider les animaux en souffrance ?
Nous parlons ici d’une discipline particulière qui est en vogue depuis quelques années et fait intervenir des communicants animaliers. Ces “chuchoteurs” mis en avant par le livre de Nicholas Evans et le film L’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux exploitent une autre dimension de la communication interspécifique, qui n’est pas accessible à tous.
Cette communication dite aussi intuitive peut se faire en présence de l’animal ou à distance. Elle requiert une dimension émotionnelle, le communicant percevant les pensées mais aussi les sensations physiques de l’animal qui, rappelons-le, est un être conscient et ressent, comme l’humain, toutes sortes de sentiments variés.
En se connectant ainsi aux animaux, les communicants arrivent à cerner des problèmes qui ne sont pas visibles par la simple observation ou l’examen clinique et leur apportent donc indéniablement une aide.
Un mauvais comportement est-il toujours synonyme de souffrance chez l’animal ? Comment apprendre à décrypter le comportement de son animal de compagnie ? Que conseil pourriez-vous donner à des propriétaires qui y sont confrontés ?
Tout dépend du comportement et du contexte dans lequel il s’exprime. Certains mauvais comportements naissent d’une communication perturbée entre l’animal et son propriétaire. En agissant “mal”, le chien ou le chat manifeste son anxiété et son incompréhension.
Le cas classique concerne le chien laissé seul qui va manifester son anxiété par des vocalises, des destructions, de la malpropreté. Pour le propriétaire qui rentre chez lui le soir, son animal a “fait des bêtises” ou s’est vengé et mérite d’être puni. Ils sont confortés dans leur impression par l’attitude penaude du chien, tête basse, qui émet de petits gémissements et manifeste en fait par ces comportements des signaux d’apaisement.
Cette situation est incomprise par l’animal et ne va faire qu’exacerber les troubles au départ de ses propriétaires.
Il faudrait déjà conseiller aux propriétaires d’éviter toute punition a posteriori. S’ils se sentent dépassés ou ne comprennent plus leur animal, je leur recommande de se faire aider par un professionnel, vétérinaire ou éducateur, qui les accompagnera pour retrouver une bonne base de dialogue avec leur chien ou leur chat.
La vengeance et la volonté de nuire n’existent pas chez le chien et le chat. Un animal qui se comporte mal exprime donc son mal-être et montre que quelque chose ne va pas. Il faut alors trouver quoi pour rétablir la situation.
Les hommes sont capables d’une grande cruauté envers les animaux. Avons-nous toujours la faculté de nous connecter à la nature et de dialoguer avec les animaux ?
Nous sommes, je l’espère, toujours capables de communier avec la nature et les animaux.
La cruauté envers les animaux n’est malheureusement pas l’apanage de nos sociétés contemporaines. De tout temps, l’homme a été capable du pire. Aujourd’hui, ces comportements délétères sont plus visibles car décriés et sanctionnés, mais je pense qu’ils ont toujours existé, sous différentes formes.
Il ne tient qu’à nous de retrouver et d’entretenir cette faculté de connexion à la nature et aux animaux, sans être pour autant intrusifs et sans chercher à tout contrôler comme c’est trop souvent le cas dans les activités humaines.
___________
Propos recueillis par Élodie Plassat
Retrouvez Thierry Bedossa le samedi 10 avril 2021 au Grand Rex de Paris pour l’événement NATURE GUÉRISSEUSE qui rassemblera 15 experts sur le thème des trésors thérapeutiques de la nature.
Infos et réservations : www.natureguerisseuse.com
© Kevin quezada / Unsplash ; Tous droits réservés

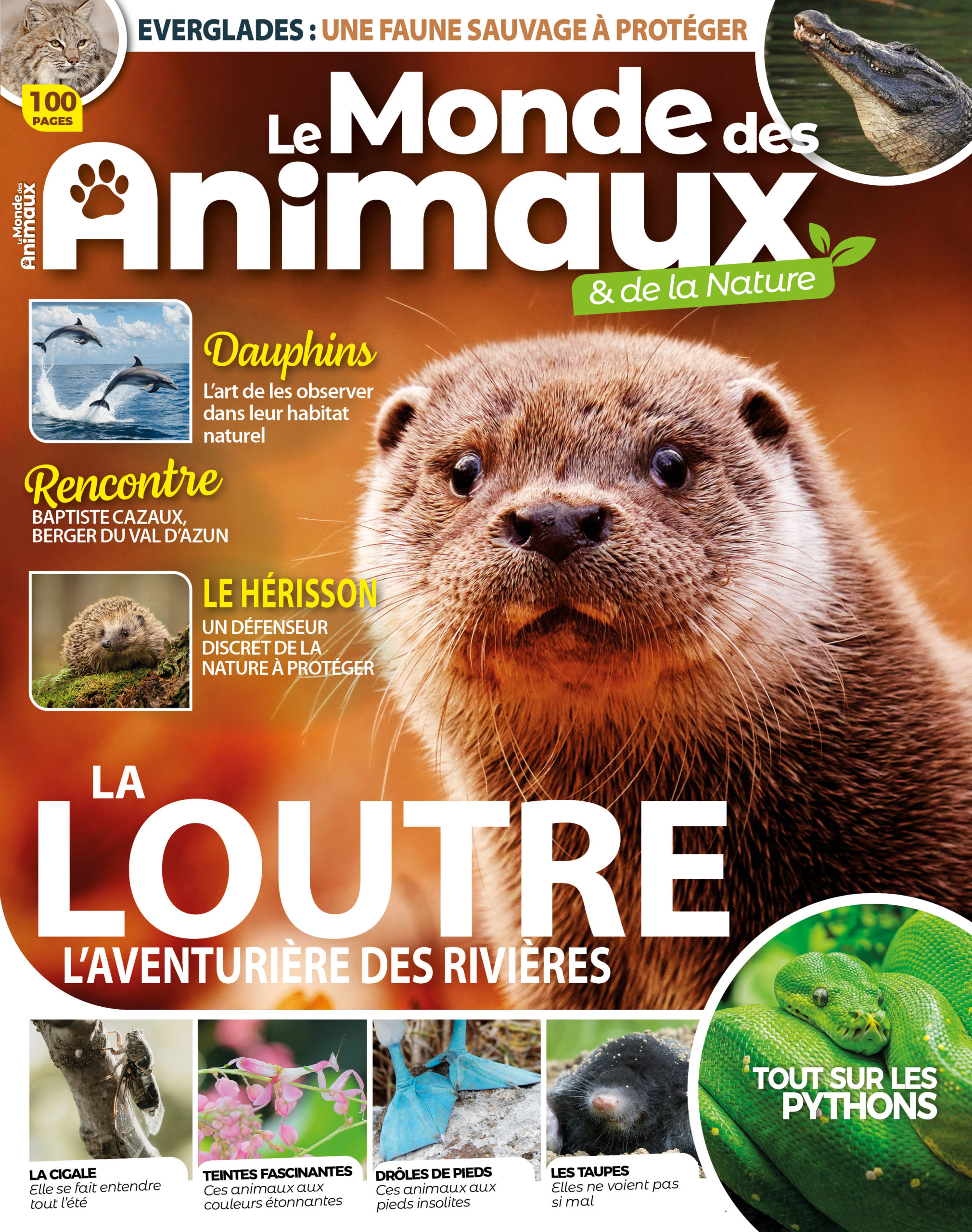






 Une tortue matamata
Une tortue matamata Une tortue d’Aldabra
Une tortue d’Aldabra










