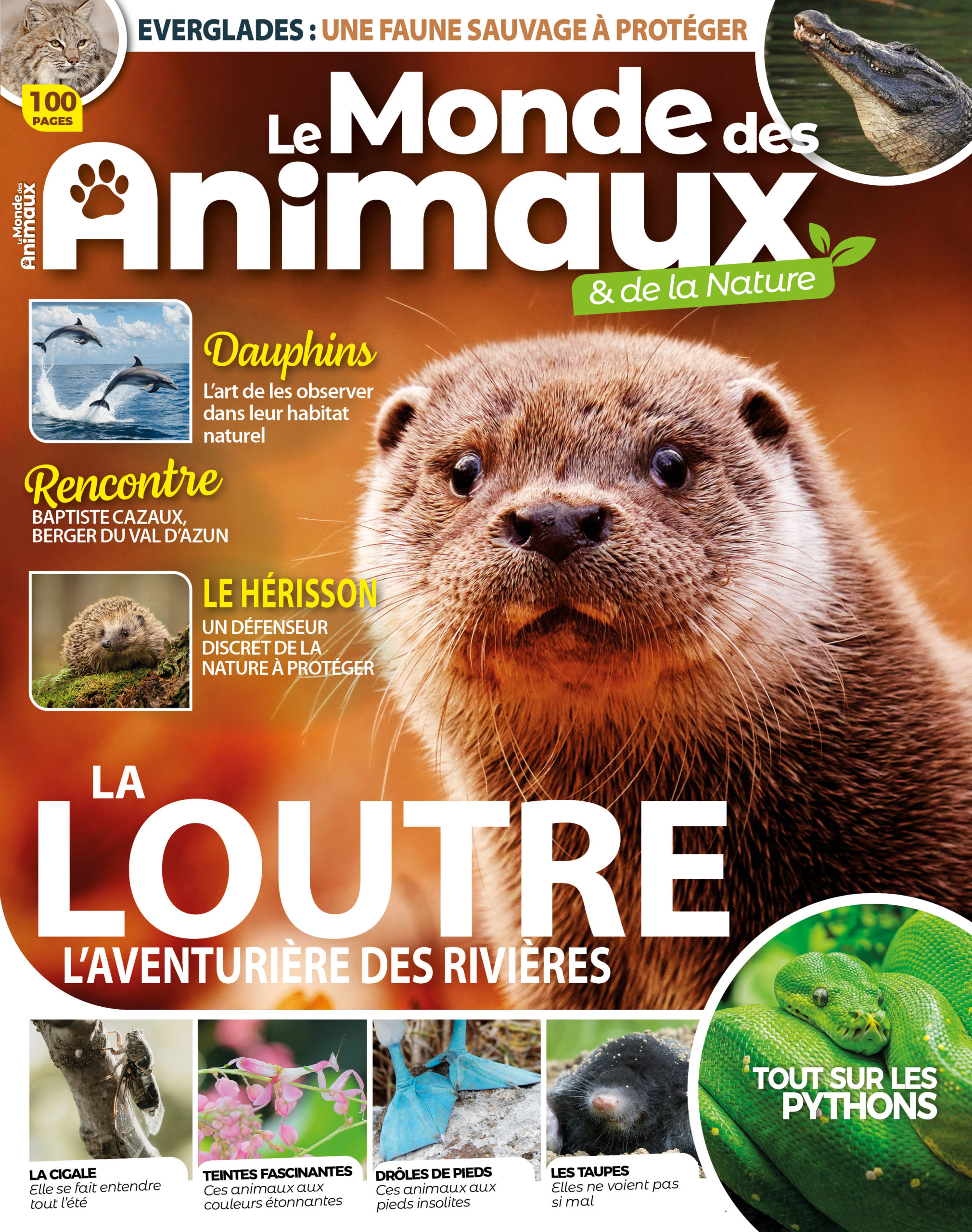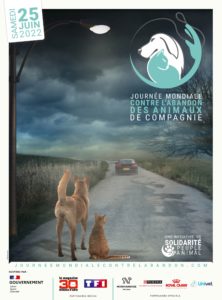Flipper [le dauphin], Cheeta [le chimpanzé compagnon de Tarzan], Willy [orque] et tant d’autres… La célébrité de ces individus privés de leur liberté s’est faite au détriment de leur espèce à l’état sauvage. Aujourd’hui, il y a probablement plus d’animaux sauvages sur les réseaux sociaux qu’il n’en reste sur la planète. Prendre une photo animalière n’a rien d’anodin. La philosophie qui la sous-tend est avant toute chose une invitation à l’observation bienveillante, respectueuse du vivant, à la sensibilisation en faveur d’une préservation des espèces.
Les chasseurs d’images armés d’un smartphone ou de tout autre appareil inadapté mitraillent l’animal, pensant capturer et mettre en boîte l’insaisissable. Il n’en est rien. À coups de Snapchat, filtres, effets de lumière, de couleurs, de montages improbables… ces circassiens de l’ère numérique exhibent leurs prises de vues sur leurs réseaux pour toujours plus de buzz dans un monde virtuel. Une localisation sur la photo et l’animal est traqué par la faune humaine comme une star par ses paparazzis, adeptes du mimétisme contribuant ainsi au trafic d’animaux ou au développement d’un tourisme de masse. Ils ont “vu”.
Une empreinte humaine de plus
Loin de nous faire prendre conscience ou d’enrichir notre connaissance pour mieux comprendre le vivant, tous ces pixels, le virtuel, quand ce ne sont pas les fakes, nous éloignent de l’essentiel. Mais la rencontre, ce face-à-face intimiste de deux sensibilités, l’émotion de la surprise, de la profondeur du regard de celui qui, dans la plupart des cas, vous observe, vous a entendu, vous a senti bien avant que vous ne l’ayez vu, où sont-ils ? Qu’en est-il de la magie de l’instant ?
Le photographe ou naturaliste s’inscrit dans une démarche d’observation bienveillante du monde sauvage, sans perturber l’animal. Il est ce témoin, celui qui transmet par l’image l’authenticité de la rencontre, du monde vivant et de l’importance de le préserver. À l’ère des influenceurs, pour le photographe animalier, c’est être en retrait, discret, garder secret le lieu où l’on a eu le privilège de croiser l’animal, de l’entrevoir, de le contempler, de vibrer, de ressentir une émotion.
Et si le vrai partage était l’instant furtif, unique, entre l’animal et vous, sans écran. Aucune image figée ou animée ne peut retranscrire votre ressenti, votre perception individuelle, personnelle, exclusive.
Redonner du sens à la photo, s’interroger sur l’opportunité de prendre une photo de plus, sans que celle-ci se retrouve noyée dans les milliers d’autres accumulées, stockées dans le cloud dont on oublie souvent l’impact environnemental, qui n’a rien de virtuel, lui. La photo laisse une empreinte humaine de plus dans le monde sauvage.
Préserver l’ensemble des animaux sauvages
Est-il encore besoin de rappeler que l’animal sauvage est un être doué de sensibilité plurielle, tout comme l’animal de compagnie, tout comme l’humain. En 2022, l’Équateur reconnaît des droits aux animaux sauvages. En France, les actes de cruauté sur un animal sauvage ne font l’objet d’aucune sanction, à la différence des animaux domestiques.
Si des normes internationales, européennes et françaises tendent à protéger l’habitat des animaux sauvages, toute intrusion dans leur environnement les expose à un déséquilibre de leur écosystème, menace leur survie. Il est essentiel de respecter les règles existantes sur ces territoires tels que les parcs naturels, les espaces Natura 2000 ou toute autre zone protégée, et de demander les autorisations aux autorités compétentes pour des besoins spécifiques qui dérogeraient à ces règles.
Le photographe animalier peut contribuer à leur préservation pour autant qu’il connaisse et respecte l’animal, les caractéristiques de son espèce, son biotope, son régime alimentaire, ses comportements d’inquiétude, de fuite, de parade sexuelle, qu’il connaisse aussi les périodes d’épuisement dues à la sortie d’hibernation ou celle d’accouplement, de nidification, sa zone territoriale, autant de situations où l’homme peut être perçu comme une menace, un prédateur.
Bannir les selfies
Nous, photographes et naturalistes, appelons les photographes professionnels ou amateurs à défendre une éthique de la photo animalière, à l’instar d’initiatives d’association, qui consiste à :
– bannir les selfies avec l’animal sauvage ;
– proscrire tout contact physique avec l’animal : ne pas le toucher, le manipuler, le contraindre ni le déplacer, autant d’interactions sources de stress pour l’animal ;
– ne pas nourrir l’animal, même s’il s’approche, toute imprégnation avec l’humain l’expose au rejet par son espèce et à la traque humaine ;
– s’éloigner des nids, terriers, tanières ou des animaux juvéniles, même s’ils sont loin de leur mère. Dans tous les cas, conserver des distances raisonnables et de sécurité ;
– alerter les organismes ou autorités compétents pour la préservation des animaux sauvages s’il vous semble qu’un animal sauvage a besoin d’assistance. Ne pas le toucher ;
– s’assurer de laisser une empreinte minimale de son passage : aucun déchet, qu’il soit naturel ou pas ;
– aucune pollution lumineuse (flash, lampe) ou olfactive (feux de camp, parfums, aliments) : c’est au photographe de s’adapter avec la lumière naturelle pour ne pas perturber l’animal et son écosystème ;
– observer le silence (ni voix, ni musique, ni téléphone ou quelque autre bruit) ;
– ne pas indiquer le lieu de prise de photo sur vos partages sur les réseaux sociaux pour éviter le “tourisme de masse“.
Aucune photo ne remplace l’émotion de la rencontre. Respecter l’animal et son habitat, c’est préserver son espèce. Vivez l’instant unique qu’il vous offre comme un moment de grâce.
*****
Texte à l’initiative de Béatrice Babignan, avocate au Barreau de Paris ; Marie-Bénédicte Desvallon ; Magali Greiner, avocate au Barreau de Paris ; Corinne Lesaine est docteure vétérinaire et Ludovic Sueur, photographe animalier, auteur et conférencier.
“Pour une photographie animalière éthique et responsable“, tribune publiée en ligne dans Le Monde, le 11 mai 2022.
Photo © Diana Parkhouse / unsplash